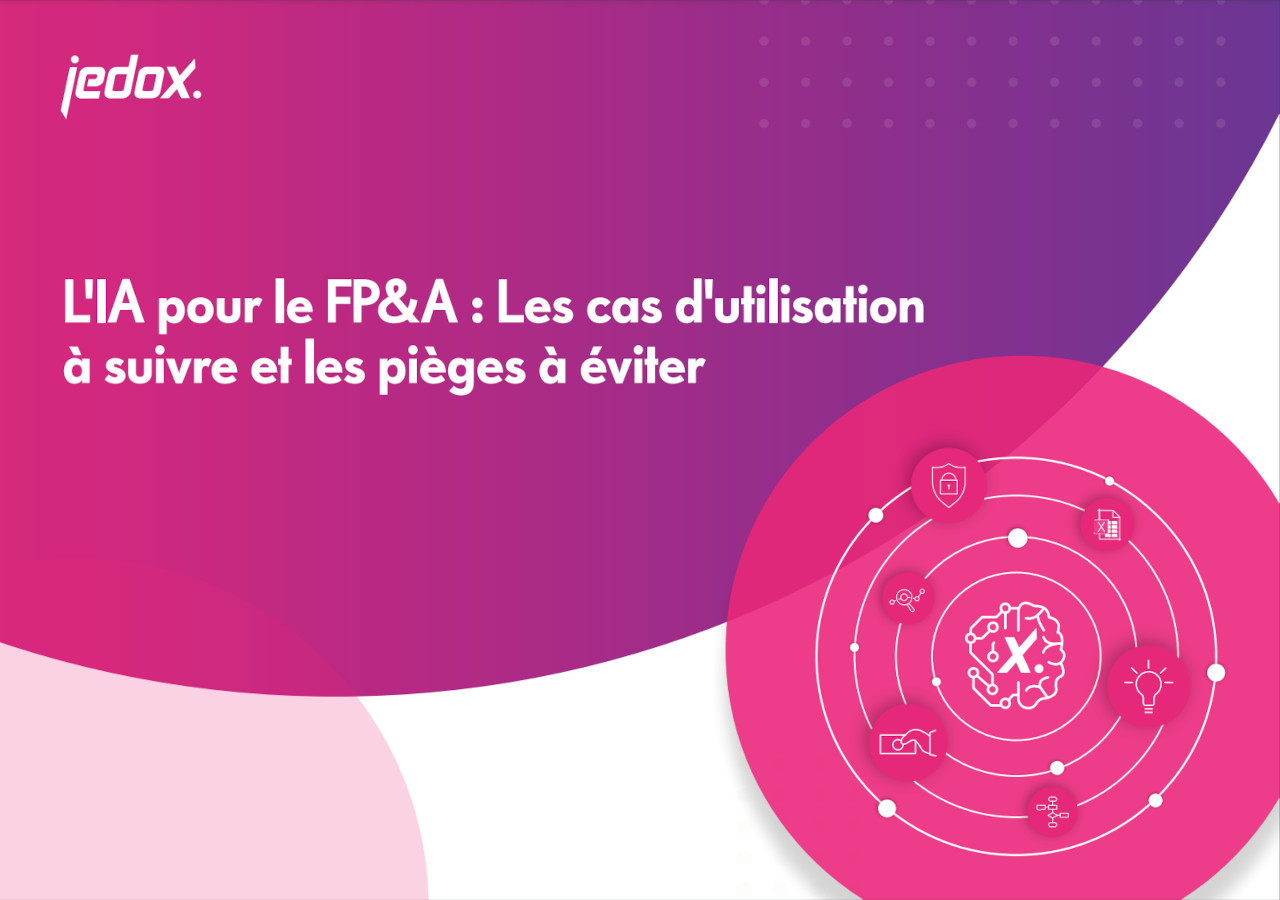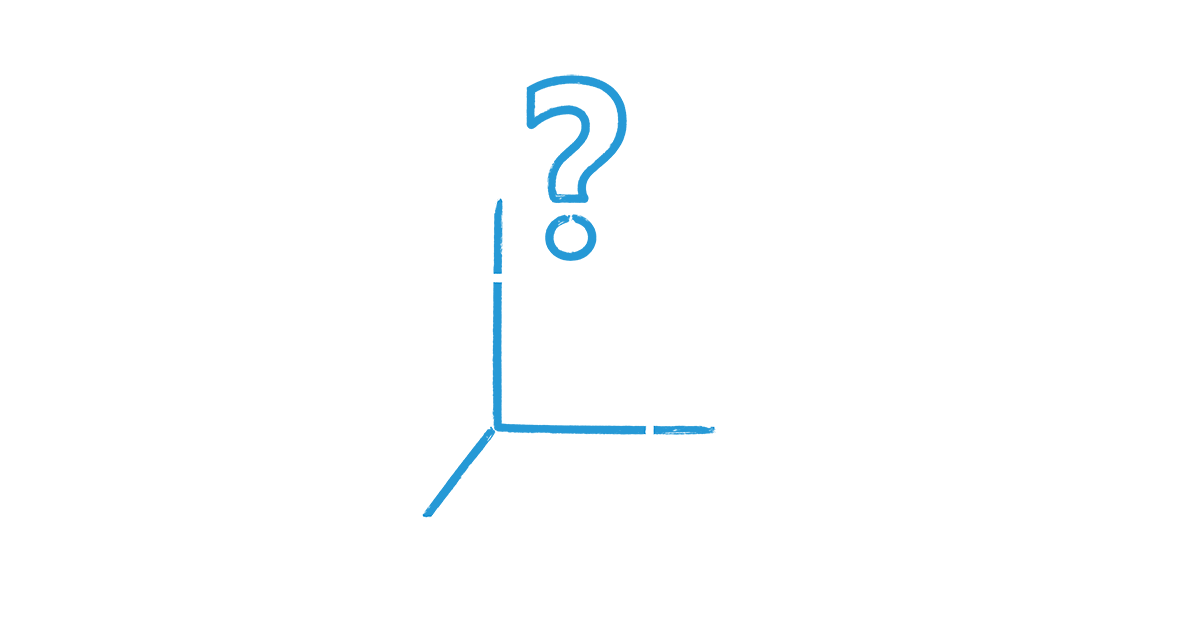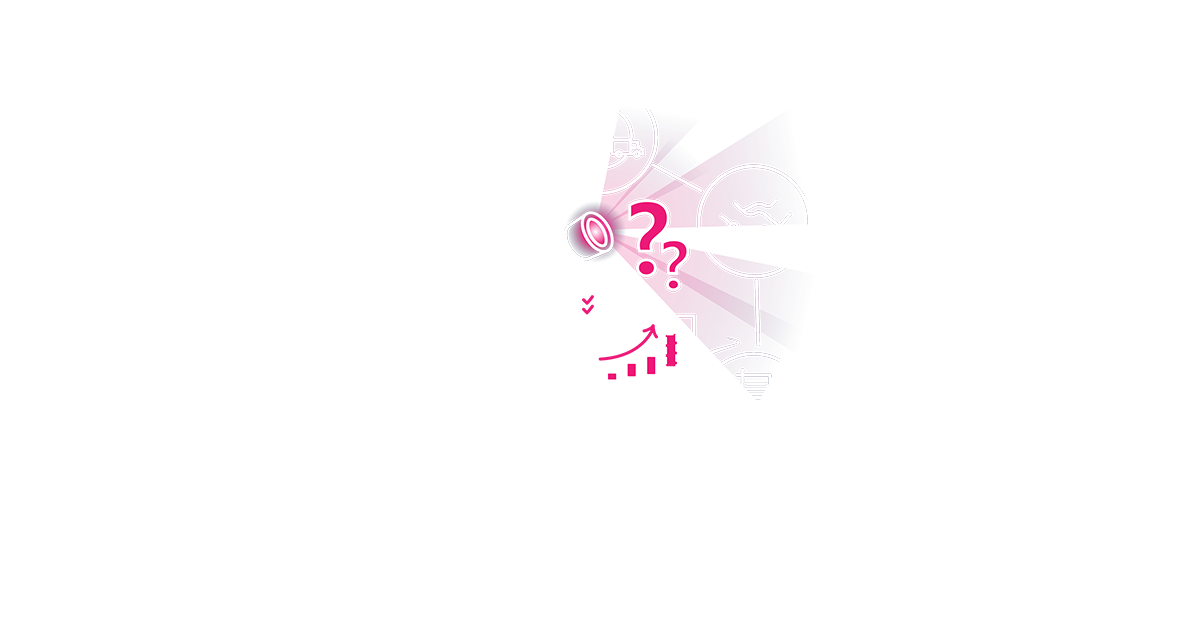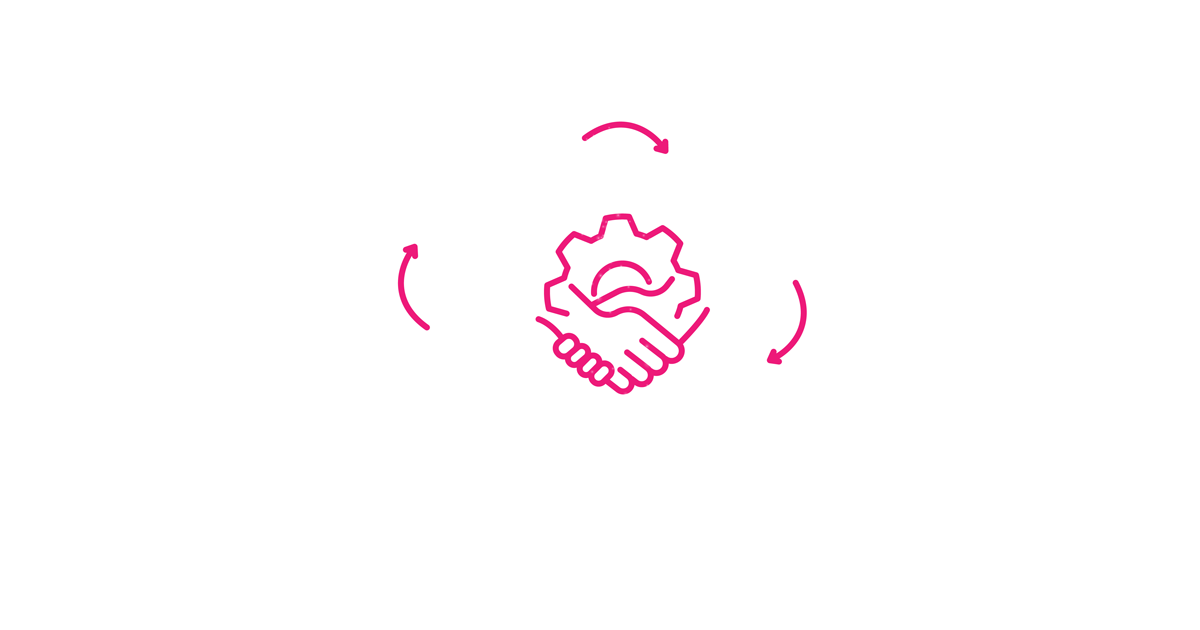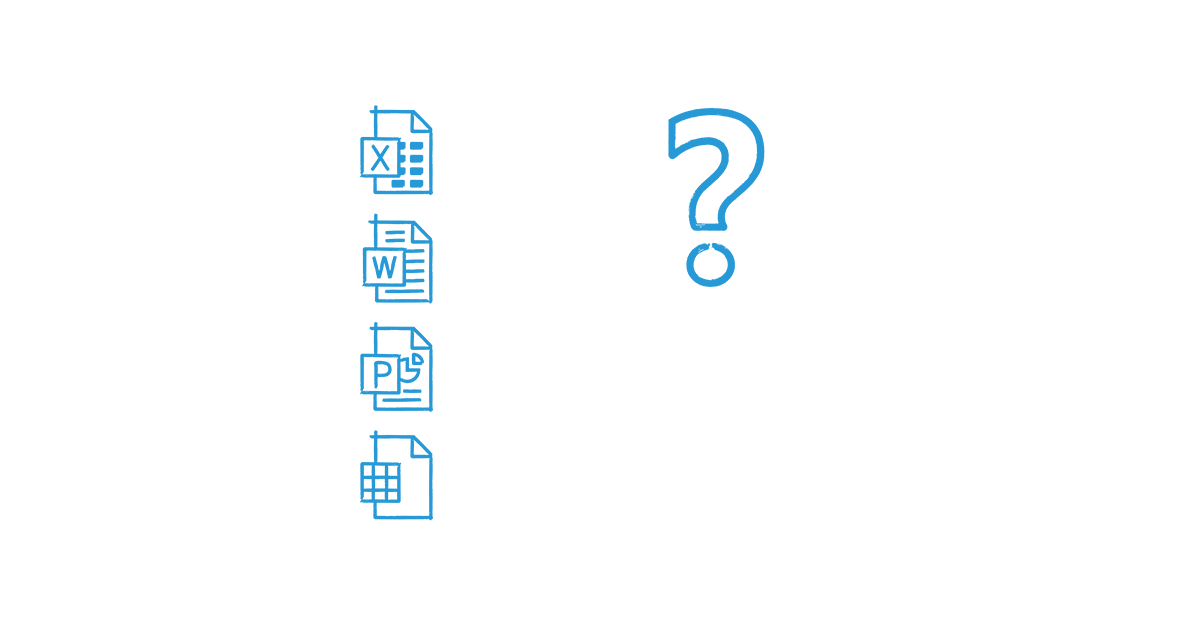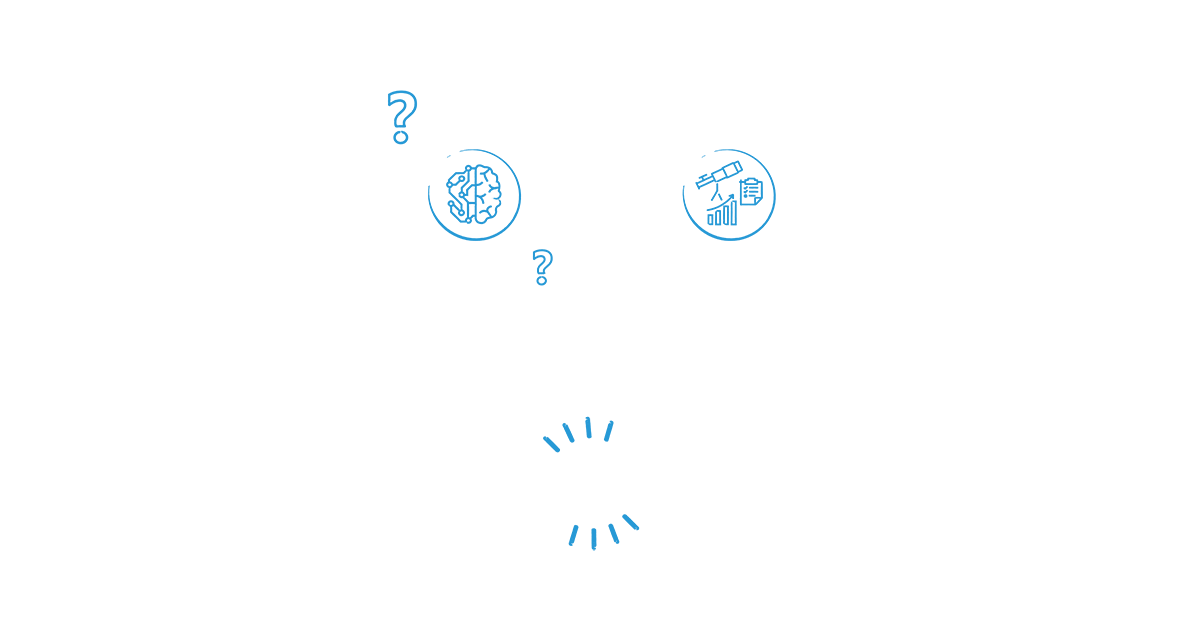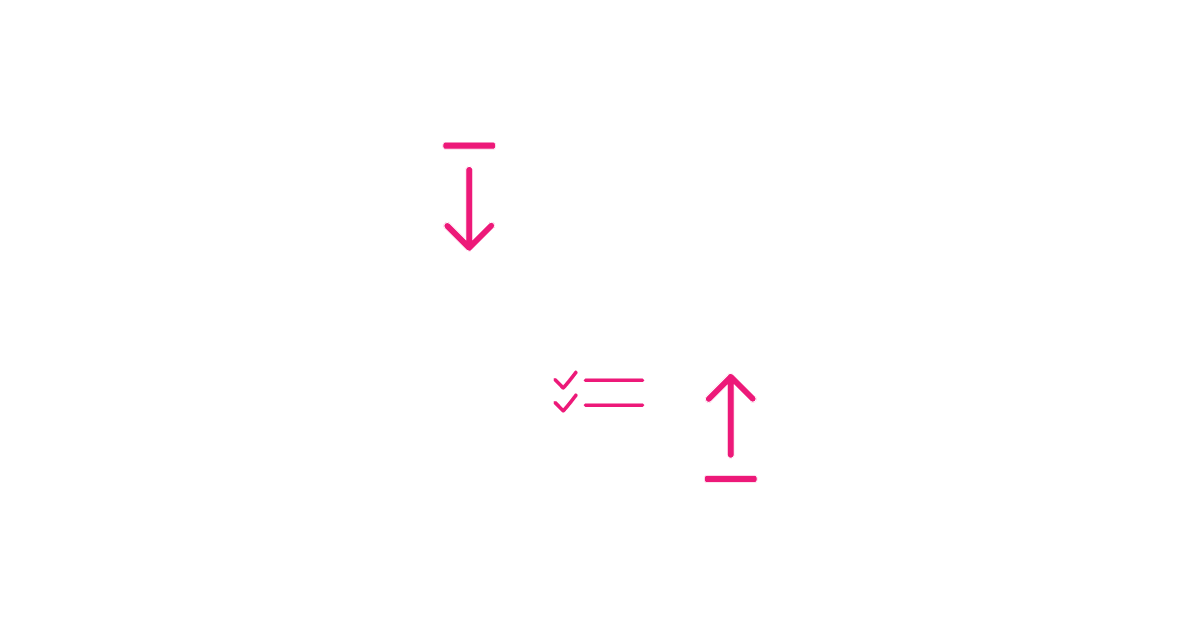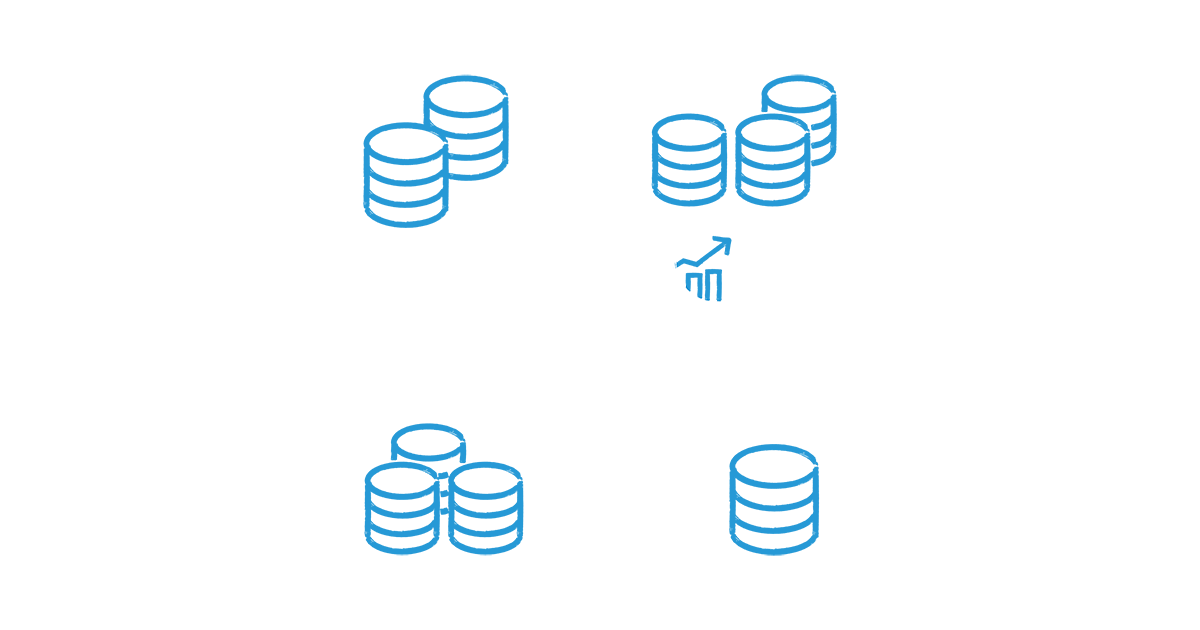11 KPIs financiers pour piloter votre entreprise
Déterminer les bons indicateurs clés de performance financière (KPI) pour votre entreprise est essentiel, car ils fournissent des informations précieuses pour vos activités de planification et d’analyse financière (FP&A). Les KPIs vous permettent de mesurer la performance, d’identifier les tendances et de prendre des décisions alignées sur vos objectifs stratégiques.
Les indicateurs à privilégier dépendent de votre secteur, de votre modèle d’entreprise et de vos objectifs spécifiques. Certains KPIs, comme la marge brute ou les flux de trésorerie, sont universels, tandis que d’autres sont propres à certains secteurs. Par exemple, les industriels doivent surveiller leurs stocks, tandis que les entreprises SaaS ou avec un modèle d’abonnement se concentrent sur le revenu annuel récurrent. Dans cet article, nous vous proposons des formules, des exemples et des conseils pour vous aider à choisir les bons KPIs financiers pour une planification financière d’entreprise efficace.
Qu’est-ce qu’un KPI ?
Le KPI (Key Performance Indicator), ou indicateur clé de performance, est une mesure chiffrée utilisée pour évaluer l’atteinte d’un objectif spécifique. Qu’il s’agisse de mesurer l’avancement d’un projet ou l’efficacité d’une stratégie, définir des KPI adaptés permet de gérer l’entreprise de manière structurée et méthodique.
Un KPI ne se limite pas à un simple chiffre : il constitue un outil stratégique qui facilite la prise de décisions. Il apporte une vision claire des résultats, signale les écarts éventuels et assure une meilleure cohérence entre les objectifs fixés et les actions menées par les équipes.
Pour suivre efficacement vos KPI, l’utilisation d’un tableau de bord dédié est fortement conseillée afin de centraliser et analyser facilement vos données.
Qu’est-ce qu’un KPI financier ?
Les KPI financiers sont des indicateurs que les entreprises utilisent pour suivre, mesurer et analyser leur santé financière. Ils se répartissent en plusieurs catégories : Rentabilité, Liquidité, Efficacité opérationnelle, Levier financier, Flux de trésorerie et Croissance
Comment choisir les bons indicateurs en finance ?
- Alignez les KPI avec les objectifs de l’entreprise : assurez-vous qu’ils reflètent les priorités comme la rentabilité (marge brute, résultat d’exploitation).
- Assurez-vous que vos KPI sont équilibrés et couvrent les revenus, les coûts, la trésorerie et la rentabilité, sans trop insister sur un domaine. Évitez les indicateurs qui font bien sur le papier mais apportent peu de valeur ajoutée.
- Pour chaque KPI :
✓ Assignez un responsable
✓ Définissez les formules
✓ Fixez des objectifs spécifiques et des fourchettes acceptables
✓ Identifiez la source des données (ex. logiciel comptable, système ERP, etc.)
✓ Planifiez les révisions (ex. hebdomadaires, mensuelles) - Nous recommandons fortement d’utiliser un tableau de bord financier pour un suivi centralisé.
Indicateurs de rentabilité
Les KPIs de rentabilité mesurent la capacité d’une entreprise à générer des bénéfices en rapport à son chiffre d’affaires, ses actifs ou ses capitaux propres.
Marge brute
La marge brute ou marge commerciale indique combien d’argent il reste à une entreprise après avoir payé les coûts des biens qu’elle vend. Cela montre la rentabilité des opérations principales de l’entreprise.
Marge brute = Chiffre d’affaires HT – Coût des marchandises vendues HT
Taux de marque = (Marge brute / Chiffre d’affaires HT ) x 100
- Marge brute : Vos revenus totaux moins le coût de revient des biens vendus.
- Chiffre d’affaires HT : Vos revenus totaux après déduction des retours clients, réductions ou offres spéciales.
Un taux de marque élevé signifie que l’entreprise génère des bénéfices solides grâce à ses ventes, que ce soit via des prix élevés, des coûts de production faibles ou d’importants volumes de ventes. Un taux bas indique que l’entreprise ne tire pas suffisamment de profit de ses ventes.
Qu’est-ce qu’une bonne marge brute ?
En janvier 2025, NYU Stern a publié des données moyennes par secteur :
- Éducation : 41,15 %
- Machinerie : 37,08 %
- Promoteurs immobiliers : 35,13 %
- Services pétroliers : 10,71 %
- Supermarchés : 26,09 %
- Logiciels : Parmi les marges les plus élevées (Internet : 60,82 %, Divertissement : 65,38 %, Systèmes & applications : 72,38 %).
Marge opérationnelle
La marge opérationnelle ou marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation (REX) divisé par le chiffre d’affaires (CA).
La marge opérationnelle indique la performance économique d’une entreprise. Elle représente le profit extrait de chaque euro de chiffre d’affaires avant de prendre en compte le résultat financier, les impôts, ou les événements exceptionnels.
- Résultat d’exploitation : c’est un solde intermédiaire de gestion qui reflète l’argent qu’une entreprise gagne grâce à son activité principale. Le résultat d’exploitation ne tient pas compte des produits ou charges financiers, des événements exceptionnels, des impôts sur les bénéfices ou de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise. Il peut être calculé à partir d’une balance comptable ou d’un compte de résultat de la façon suivante:REX = produits d’exploitation – charges d’exploitation.
- Les produits d’exploitation représentent l’ensemble des revenus générés par l’activité courante et principale d’une entreprise. Cela inclut, par exemple, le chiffre d’affaires provenant de la vente de biens ou services, les subventions d’exploitation, ou encore les revenus accessoires liés à l’activité (comme la location de matériel).
- Les charges d’exploitation regroupent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement quotidien de l’entreprise. Cela comprend les coûts d’achat de matières premières, les salaires, les charges sociales, les loyers, les frais d’entretien, ou encore les dépenses énergétiques.
Exemple : Supposons que vous ayez réalisé 750 000 € de chiffre d’affaires et 300 000 € de résultat d’exploitation.
Marge opérationnelle = (300 000 / 750 000) x 100 = 40 %
Ce qui signifie que chaque euro de chiffre d’affaires génère 40 centimes de richesse pour l’entreprise.
Qu’est-ce qu’une bonne marge opérationnelle ?
En général, plus la marge est élevée, mieux c’est. Mais souvenez-vous que les marges d’exploitation varient selon les secteurs. Par exemple, les consultants ou comptables avec peu de frais généraux ont souvent des marges plus élevées que les entreprises avec des coûts de production importants.
Les soldes intermédiaires de gestion
Les soldes intermédiaires de gestion (SIG) décomposent le résultat d’une entreprise en plusieurs indicateurs clés. Cela permet de mieux comprendre la performance de l’entreprise et comment elle génère profits ou pertes.
Pour calculer les SIG, on utilise les mêmes informations que pour le compte de résultat, c’est-à-dire les produits (recettes) et les charges (dépenses).
- La production de l’exercice ;
- La marge commerciale ;
- La valeur ajoutée (VA) ;
- L’excédent brut d’exploitation (EBE) ;
- Le résultat d’exploitation (REX) ;
- Le résultat courant avant impôt ;
- Le résultat exceptionnel ;
- Le résultat net ;
- Les plus-values et les moins-values sur cession d’éléments actifs.
Excédent brut d’exploitation (EBE)
L’EBE permet de déterminer ce qui reste dans l’entreprise une fois les salariés, les taxes et les impôts payés. Cet indicateur mesure les ressources générées par l’activité principale d’une entreprise. Il ne prend pas en compte sa politique financière, les amortissements ou les événements exceptionnels.
Ce solde intermédiaire de gestion se calcule de trois façons différentes :
- Calcul à partir de la valeur ajoutée :EBE = Valeur ajoutée + Subventions d’exploitation (compte 74) – Impôts et taxes (compte 63) – Charges de personnel (compte 64)
- Calcul à partir du résultat net :EBE = Résultat net + Charges financières (compte 66) – Produits financiers (compte 76) + Charges exceptionnelles (compte 67) – Produits exceptionnels (compte 77) + Dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) – Reprises sur amortissements et provisions (compte 78) – Autres produits de gestion courante (75) + Autres charges de gestion courante (65)
- Calcul à partir du chiffre d’affaires :EBE = Chiffre d’affaires HT (compte 70) – Achats consommés (compte 60) – Consommation en provenance de tiers (comptes 61 et 62) + Subventions d’exploitation (compte 74) – Charges de personnel (compte 64) – Impôts et taxes (compte 63)
Qu’est-ce qu’un bon EBE ?
Un EBE élevé montre une bonne rentabilité opérationnelle tandis qu’un EBE faible ou négatif peut indiquer des dépenses trop élevées ou un revenu insuffisant. Si l’EBE augmente, c’est un signe de croissance, mais une baisse peut révéler une perte de performance. Cependant, l’EBE a ses limites : il ne prend pas en compte les intérêts de la dette ni les produits financiers, ce qui peut fausser l’analyse d’entreprises très endettées.
Indicateurs de liquidité
Les indicateurs de liquidité évaluent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations financières à court terme.
Ratio de liquidités immédiate
Le ratio de liquidité immédiate indique si une entreprise peut payer ses dettes à court terme en utilisant uniquement sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie. C’est une mesure de liquidité stricte, car elle ne prend en compte que l’argent immédiatement disponible sans avoir à convertir d’autres actifs.
Autrement dit, une entreprise examine ce ratio pour vérifier si elle a assez de liquidités pour régler ses dettes immédiates.
Trésorerie et équivalents de trésorerie : Fonds en liquide ou facilement convertibles en liquide.
Passif court terme : Dettes à payer dans un délai d’un an ; comprend les comptes créditeurs et autres dettes à court terme.
Qu’est-ce qu’un bon ratio de liquidité immédiate ?
Il n’y a pas de règle universelle. Beaucoup d’entreprises visent un ratio de 1,0, c’est-à-dire suffisamment de liquidités pour couvrir leurs dettes à court terme, mais c’est rare. La plupart des entreprises évitent un ratio aussi élevé par peur de manquer une opportunité d’investissement. Un ratio entre 0,5 et 1,0 est correct et montre qu’une entreprise peut respecter ses obligations. Un ratio inférieur à 0,5 peut signaler des problèmes de liquidité, tandis qu’un ratio supérieur à 1,5 suggère une utilisation inefficace des actifs.
Indicateurs d’efficacité opérationnelle
Les indicateurs d’efficacité opérationnelle évaluent l’utilisation des ressources par une entreprise pour générer des revenus.
Délai moyen de recouvrement
Le délai moyen de recouvrement (DSO pour Day Sales Outstanding) mesure le temps qu’une entreprise met à encaisser les paiements après une vente. Un recouvrement rapide soutient la santé financière, permettant de remplir les obligations, d’investir et de fonctionner sans accroc. Un DSO faible signifie des rentrées de fonds rapides, aidant à couvrir les dépenses. Un DSO élevé signifie des délais de paiement plus longs. Un DSO élevé persistant peut indiquer des problèmes de crédit client, de facturation ou de politiques de crédit.
- Période : La période choisie (mois, trimestre, année)
- Encours clients : Argent dû par les clients à la fin de la période
Exemple :
Encours clients : 90 000 €
CA : 450 000 €
Période : 365 jours
Divisez les encours clients par le chiffre d’affaires : 90 000 € / 450 000 € = 0,20
Multipliez par le nombre de jours : 0,20 x 365 = 73 jours
Le résultat correspond au nombre de jours moyen que met votre entreprise pour recouvrer un paiement après une vente. Dans cet exemple, les clients mettent en moyenne 73 jours pour payer leurs factures.
Qu’est-ce qu’un bon DSO ?
Un DSO plus bas est généralement préférable, la plupart des entreprises visant un DSO de moins de 45 jours.
Cependant, ce qui constitue un “bon” DSO dépend du secteur d’activité. Par exemple, un DSO de 85 jours peut être typique pour un fabricant industriel vendant des équipements coûteux, mais serait préoccupant pour un détaillant de vêtements qui attend des paiements rapides. Les entreprises saisonnières ou cycliques peuvent également observer des variations naturelles du DSO en fonction du calendrier des ventes.
Indicateurs de flux de trésorerie
Cette catégorie concerne le suivi des flux de trésorerie.
Flux de trésorerie d’exploitation (Operating cash flow, OCF)
Le Flux de Trésorerie d’Exploitation (FTE) encore connu sous le nom d’OCF (Operating Cash Flow) ou Flux de Trésorerie de l’Activité (FTA) représente les liquidités générées par les activités principales d’une entreprise, c’est-à-dire la vente de produits ou de services.
L’OCF se concentre sur les liquidités générées par les activités principales de l’entreprise. La formule peut varier légèrement en fonction de la méthode utilisée (directe ou indirecte), mais la méthode indirecte présentée ici est l’approche la plus courante. Les frais hors caisse comprennent les amortissements et provisions, tandis que les variations du fonds de roulement font référence aux variations des comptes clients, des comptes fournisseurs ou des stocks. Le calcul se décompose de la façon suivante :
- Partir du bénéfice net : Le bénéfice net est le point de départ du calcul, généralement issu de votre compte de résultat.
- Ajouter les charges non monétaires :
- Amortissements : Ils représentent la perte de valeur des immobilisations, mais ne correspondent pas à une sortie de trésorerie réelle. Il faut donc les réintégrer.
- Provisions : Similaires aux amortissements, elles sont des charges comptables qui ne sont pas des sorties d’argent.
- Adapter pour la variation du BFR : C’est l’ajustement le plus important pour refléter l’impact sur la trésorerie.
✓ Augmentation des stocks ou des créances clients : Cela représente un besoin de trésorerie (moins de cash disponible), donc une soustraction.
✓ Diminution des stocks ou des créances clients : Cela libère de la trésorerie, donc une addition.
✓ Augmentation des dettes fournisseurs ou fiscales : Cela apporte de la trésorerie, donc une addition.
✓ Diminution des dettes fournisseurs ou fiscales : Cela coûte de la trésorerie, donc une soustraction.
Qu’est-ce qu’un bon flux de trésorerie d’exploitation ?
Les entreprises dont le ratio de trésorerie d’exploitation est stable ou en amélioration sont généralement considérées comme financièrement saines. Le ratio de trésorerie d’exploitation se calcule comme suit :
Exemple : Si le flux de trésorerie d’exploitation est de 200 000 € et le passif courant de 100 000 €, le ratio est de 2. Cela signifie que l’entreprise génère 2 € de trésorerie d’exploitation pour chaque euro de passif courant. L’entreprise peut donc couvrir ses obligations à court terme 2 fois.
- Un ratio inférieur à 1 signifie que l’entreprise ne génère pas suffisamment de liquidités de ses opérations pour couvrir ses dettes à court terme.
- Un ratio supérieur à 1 est préféré par les investisseurs, car il montre que l’entreprise peut remplir ses obligations à court terme et conserver des liquidités.
Indicateurs de croissance d’entreprise
Ces indicateurs financiers mesurent la croissance d’une entreprise.
Croissance du chiffre d’affaires
Cette méthode consiste à calculer la variation du chiffre d’affaires entre deux périodes, généralement d’une année à l’autre ou d’un trimestre à l’autre.
Ce calcul est simple et fournit une vue d’ensemble de l’évolution du chiffre d’affaires. En revanche, il ne tient pas compte de la saisonnalité ou des événements ponctuels et n’est pas forcément adapté à une analyse à long terme.
Par exemple, si votre chiffre d’affaires était de 3 millions d’euros l’année dernière et de 4,5 millions cette année, votre croissance est de 50 %. Le calcul de la croissance du chiffre d’affaires n’est que la première étape. Vous devez également l’analyser en lien avec d’autres indicateurs comptables. Avec un modèle par abonnement, le revenu récurrent est crucial, donc intégrer le taux de churn aussi appelé taux d’attrition est essentiel pour une analyse complète.
Qu’est-ce qu’un bon taux de croissance ?
Pour répondre à cette question, il faut vous référer à votre secteur d’activité. De manière générale, les entreprises établies visent souvent une croissance annuelle de 10 à 20 %. Les nouvelles entreprises ou celles venant de secteurs à forte croissance peuvent viser des taux plus élevés.
Taux de croissance annuel composé
Le TCAC (Taux de Croissance Annuel Composé) est un outil simple et efficace pour évaluer et comparer la performance d’investissements dont la valeur change au fil du temps. Les investisseurs s’en servent pour comparer la performance d’une action face à d’autres actions ou à un indice boursier. Ceci dit, le TCAC n’est pas le rendement réel. Il montre comment un investissement aurait progressé s’il avait eu un taux de croissance constant et si les bénéfices avaient été réinvestis chaque année.
VF = Valeur finale
VI = Valeur initiale
n = nombre d’années
Exemple : Imaginez avoir placé 20 000 € dans un portefeuille d’actions.
- Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021, votre portefeuille est passé à 25 000 € (soit +25 % la première année).
- Au 1er janvier 2022, le portefeuille s’élevait à 27 500 € (soit +10 % de janvier 2021 à janvier 2022).
- Au 1er janvier 2023, le portefeuille valait 34 925 € (soit +27 % de janvier 2022 à janvier 2023).
Les taux de croissance annuels ont été différents, mais le TCAC lisse cette variation. Sur cette période de trois ans, le TCAC est de 21,31 %.
TCAC = ((34925/20000)^1/3 – 1) x 100 = 21,31 %
Un TCAC de 21,31 % sur trois ans aide un investisseur à comparer différentes options de placement ou à prévoir les rendements futurs.
Beaucoup d’investisseurs préfèrent le TCAC car il lisse la volatilité des taux de croissance annuels. En effet, même une entreprise très rentable et prospère peut connaître des années difficiles.
Qu’est-ce qu’un bon taux de croissance annuel composé ?
Le TCAC (Taux de Croissance Annuel Composé) peut varier énormément selon le stade de l’entreprise et son secteur d’activité.
- Pour les start-ups et entreprises à forte croissance, un TCAC de 20 % à 50 % est fréquent, surtout dans des secteurs comme la technologie ou le SaaS.
- Les entreprises de taille moyenne considèrent un TCAC de 15 % à 25 % comme un signe de croissance saine.
- Quant aux entreprises matures et établies, un TCAC de 5 % à 10 % est jugé solide, particulièrement s’il s’agit d’entreprises qui versent des dividendes.
RRA/RRM
Le Revenu Récurrent Annuel (RRA) est le revenu qu’une entreprise prévoit de gagner de manière stable et répétée sur un an, grâce à ses produits ou services. Les entreprises avec une stratégie d’abonnement s’en servent pour estimer leurs revenus futurs.
Le RRA est très utilisé dans les entreprises de logiciels (SaaS), les services de streaming, les forfaits téléphoniques et tout autre secteur qui propose des abonnements réguliers.
Par exemple, imaginons une entreprise de logiciels avec 8 millions d’euros d’abonnements annuels. Elle perçoit 500 000 € supplémentaires en frais de maintenance, mais perd chaque année environ 3 % de ses clients, ce qui correspond à une perte de 240 000 €.
Le calcul du revenu annuel récurrent (ARR) est le suivant : 8 000 000 € + 500 000 € – 240 000 € = 8 260 000 €.
Le revenu récurrent annuel est calculé sur une base annuelle, alors que le Revenu Récurrent Mensuel (RRM) offre une analyse détaillée des évolutions d’un mois à l’autre. Si vous ajustez vos prix en avril, vous pourrez en observer l’impact en mai. Le RRM est également utile pour suivre les variations de revenus liées aux tendances saisonnières ou aux changements économiques.
Coût d’acquisition client
Le Coût d’Acquisition Client (CAC) correspond à la somme totale qu’une entreprise investit pour acquérir un nouveau client. C’est un indicateur clé pour évaluer la rentabilité d’un client et l’efficacité de vos stratégies de vente.
Pour en savoir plus sur le CAC, consultez notre article sur les KPIs de vente.
Valeur à vie du client (Customer Life Time Value)
La valeur à vie du client (LTV, CLTV ou CLV) correspond au montant total qu’une entreprise peut s’attendre à recevoir d’un client tout au long de la relation commerciale. Elle mesure la contribution globale d’un client à votre activité sur une période donnée.
Il existe de nombreuses façons de calculer la valeur à vie du client. Voici une formule simple :
La valeur à vie du client est essentielle pour la croissance des entreprises SaaS car :
- Une valeur élevée indique une forte adéquation produit/marché et une grande fidélité des clients. Elle prouve que votre offre répond à leurs attentes.
- Le coût d’acquisition d’un client peut dépasser le montant de son premier achat. Pourtant, ce client pourrait rapporter bien plus à long terme. C’est là que le calcul de la valeur à vie du client prend tout son sens.
Configurez vos KPI financiers en une seule étape, utilisez-les à l’infini
Une fois vos KPIs sélectionnés, l’enjeu principal devient leur suivi et leur optimisation.
Sur Excel, vos indicateurs doivent constamment être ajustés manuellement. Par exemple, la méthode de calcul d’un KPI peut être différente en fonction de l’utilisation de données réelles ou de données prévisionnelles.
Une plateforme telle que Jedox vous permet de définir vos KPIs en une seule étape et de les utiliser dans tous vos modèles. Le secret ? Des méthodes de calcul multidimensionnelles qui simplifient énormément la gestion de vos KPI. Améliorez la gestion de vos KPI financiers. Contactez-nous pour une démo personnalisée.
Qu'est-ce qu'un KPI financier ?
Les indicateurs clés de performance (ICP) permettent aux managers et aux experts en finance d'évaluer l'activité de l'entreprise et de mesurer l'atteinte des objectifs stratégiques. De nombreuses entreprises utilisent divers KPIs financiers pour suivre leur succès et stimuler leur développement.
Quels sont les indicateurs de performance d'une entreprise ?
Les indicateurs de performance d'une entreprise, ou KPI, sont des mesures qui évaluent l'efficacité de ses activités, classées en plusieurs catégories : financière (chiffre d'affaires, rentabilité, trésorerie), commerciale et marketing (taux de conversion, coût d'acquisition client), opérationnelle (délai d'exécution), RH (taux de turnover, satisfaction des employés) et QHSE (taux d'accidents, gestion des déchets).
Quels sont les KPI en finance ?
Les KPI financiers concernent généralement les revenus, la marge brute, le taux d'attrition et la valeur vie client. Suivre régulièrement ces indicateurs peut aider les chefs d'entreprise à répartir leur budget marketing de façon plus stratégique
Qu’est-ce qu’un solde intermédiaire de gestion ?
Un solde intermédiaire de gestion (SIG) est un indicateur financier qui découpe le compte de résultat d'une entreprise pour analyser la formation du bénéfice à chaque étape de la gestion. Il en existe 9 à savoir la production de l’exercice, la marge commerciale, la valeur ajoutée (VA), l’excédent brut d’exploitation (EBE), le résultat d’exploitation (REX), le résultat courant avant impôt, le résultat exceptionnel, le résultat net, les plus-values et les moins-values sur cession d’éléments actifs.
Comment calculer le ratio de fonds de roulement ?
Pour calculer le ratio de fonds de roulement (ou ratio de liquidité générale), vous devez diviser le total de vos actifs à court terme par le total de vos passifs à court terme. La formule est donc : Actif à court terme / Passif à court terme. Ce ratio mesure la capacité de votre entreprise à couvrir ses obligations financières à court terme.
Comment calculer le taux de marge commerciale ?
Le taux de marge commerciale est établi en fonction du coût d'achat. Il représente le pourcentage de profit généré par rapport à ce coût d'acquisition. Pour une entreprise, le taux de marge commerciale, exprimé en pourcentage, est déterminé par la formule suivante :
Taux de marge = (Marge brute / Achats consommés HT) x 100